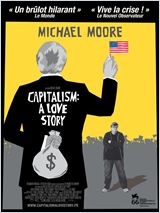
Un mois et demi après sa sortie, « Capitalism… » ne passe plus que dans deux salles à Paris.
On dira que les films de Michael Moore sont à charge , suivent une logique captieuse, que ses arguments sont fallacieux et de mauvaise foi, que ses actions et ses prises à partie sont outrées, que ses thèses sont simplistes. Pour autant, les films de Michael Moore, ces tribunes polémiques et ces vindictes rageuses contre un système américain et mondial qui vise, de manière globale, à privilégier le particulier sur le collectif, font un bien immense quand on s’installe devant. Des théories construites, implacables, qui ne visent pas à nous endormir ou à nous démontrer qu’il faut s’y faire, mais qui nous incitent à prendre parti, à nous impliquer, argumenter avec ou contre lui, mais en tout cas à nous bouger l’arrière-train. Et cela change.
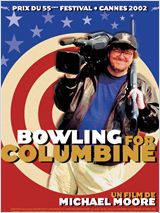
Dans la magistrale démonstration de Bowling for Columbine (2002), Michael Moore revenait sur les présupposés qui avaient contribué à cette fusillade sanglante perpétrée par deux adolescents dans leur lycée. Il signait là son premier succès, démontant les rouages, processus, préjugés et conventions d’une société américaine incitant au port d’arme, faisant de la méfiance le mode d’être en société fondamental, entretenant la peur et produisant un discours moralisateur à la fois culpabilisant (si tu ne te défends pas, tu es une mauviette) et conquérant (montre-leur de quel bois tu te chauffes). L’image qu’il offrait alors de la société américaine confinait à la caricature, un des travers qu’on lui reproche. Mais pour faire ouvrir les yeux au public, pour convaincre, il faut parfois réduire, réduire à une image qui parle d’elle-même tant elle choque. Comme l’apogée du film, cette confrontation entre les oxymores américains : l’idole d’Hollywood à la gâchette facile et l’icône exécrée réaliste et réfléchie, Charlton Heston et Marilyn Manson.
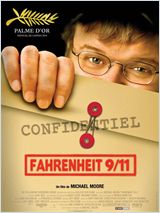 Avec cette ironie outrée qui contient avec peine la rage qu’il éprouve, Farenheit 9/11 (2004) décortique les processus, les magouilles et les intérêts financiers bien compris qui ont conduit, par-delà les attentats du 11 septembre 2001, à la deuxième guerre d’Irak. Cette thèse, reprise aujourd’hui dans Capitalism : A Love Story, est celle de la compromission des élites politiques américaines, et des différents gouvernements surtout, avec les grandes entreprises pétrolières et financières , la collusion entre les grandes familles du monde : Michael Moore y stigmatise certes la poursuite de buts privés et lucratifs mais surtout la manipulation de la population par la création et l’entretien d’une peur indicible, presque sans visage, par un discours manichéen sur les relations internationales. Plus énervé, plus brouillon aussi, plus politique car les élections présidentielles sont dans sa ligne de mire, Michael Moore trouve dans ce film ce qui fait sa marque : l’indignation, l’outrance, la jubilation. Qui servent et desservent à la fois son argumentaire.
Avec cette ironie outrée qui contient avec peine la rage qu’il éprouve, Farenheit 9/11 (2004) décortique les processus, les magouilles et les intérêts financiers bien compris qui ont conduit, par-delà les attentats du 11 septembre 2001, à la deuxième guerre d’Irak. Cette thèse, reprise aujourd’hui dans Capitalism : A Love Story, est celle de la compromission des élites politiques américaines, et des différents gouvernements surtout, avec les grandes entreprises pétrolières et financières , la collusion entre les grandes familles du monde : Michael Moore y stigmatise certes la poursuite de buts privés et lucratifs mais surtout la manipulation de la population par la création et l’entretien d’une peur indicible, presque sans visage, par un discours manichéen sur les relations internationales. Plus énervé, plus brouillon aussi, plus politique car les élections présidentielles sont dans sa ligne de mire, Michael Moore trouve dans ce film ce qui fait sa marque : l’indignation, l’outrance, la jubilation. Qui servent et desservent à la fois son argumentaire.
 J’ai alors regardé Sicko (2007), sur lequel je n’avais rien entendu ou lu, au point que je me suis demandé si quelqu’un avait vu le film… Peut-être le public s’est-il lassé de ce ton outré ? de sujets sur lesquels nous pensons être presque tous d’accord ? Et pourtant, Sicko est brillant et réjouissant, une démonstration limpides sur la responsabilité de l’Etat quant à la prise en charge médicale de ses citoyens quand les moyens et les possibilités sont là, mais que ce sont les bénéfices engrangés qui priment. Pour exposer la faillite américaine en cette matière, Michael Moore manie le rire, l’ironie, les comparaisons choc entre les Etats-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la France. Patients, prise en charge, assurances, hôpitaux, motivations et conditions de travail du personnel soignant, et surtout attention portée aux plus faibles et aux plus nécessiteux : le système américain, fondé sur le « chacun pour soi », a conduit à des situations aberrantes et scandaleuses. Parce que les soins sont « gérés » avant d’être prodigués, ne sont qu’une ligne de profit dans le bilan des grandes entreprises pharmaceutiques et des compagnies d’assurance. On suit Michael Moore, stupéfait, au gré des histoires sordides et scandaleuses d’un système de santé en perdition, face à d’autres systèmes, avec leurs écueils et leurs difficultés mais où le patient est avant tout un patient, pas un portefeuille. L’apothéose ? Je vous la laisse découvrir : elle est ironique, triste, grandiose, elle se passe à Cuba…
J’ai alors regardé Sicko (2007), sur lequel je n’avais rien entendu ou lu, au point que je me suis demandé si quelqu’un avait vu le film… Peut-être le public s’est-il lassé de ce ton outré ? de sujets sur lesquels nous pensons être presque tous d’accord ? Et pourtant, Sicko est brillant et réjouissant, une démonstration limpides sur la responsabilité de l’Etat quant à la prise en charge médicale de ses citoyens quand les moyens et les possibilités sont là, mais que ce sont les bénéfices engrangés qui priment. Pour exposer la faillite américaine en cette matière, Michael Moore manie le rire, l’ironie, les comparaisons choc entre les Etats-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la France. Patients, prise en charge, assurances, hôpitaux, motivations et conditions de travail du personnel soignant, et surtout attention portée aux plus faibles et aux plus nécessiteux : le système américain, fondé sur le « chacun pour soi », a conduit à des situations aberrantes et scandaleuses. Parce que les soins sont « gérés » avant d’être prodigués, ne sont qu’une ligne de profit dans le bilan des grandes entreprises pharmaceutiques et des compagnies d’assurance. On suit Michael Moore, stupéfait, au gré des histoires sordides et scandaleuses d’un système de santé en perdition, face à d’autres systèmes, avec leurs écueils et leurs difficultés mais où le patient est avant tout un patient, pas un portefeuille. L’apothéose ? Je vous la laisse découvrir : elle est ironique, triste, grandiose, elle se passe à Cuba…
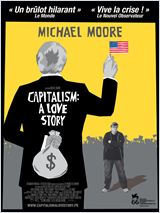 Logique, le premier film que j’ai vu en venant en France cette fois-ci a été Capitalism : A Love Story (2009), qui renoue avec la démonstration chère à Michael Moore : expliciter les tenants et les aboutissants d’un système économique et financier conduisant à des aberrations, ici personnifié, allégorisé sous les traits de Wall Street. Les expulsions, les licenciements, liés à une surenchère de paris très profitables sur des subprimes, des produits dérivés, des produits exotiques qui engagent en revanche la vie quotidienne de ceux qui ne retireront rien d’éventuels profits. Pour Michael Moore, l’origine de telles pratiques, qui détournent le capitalisme ou peut-être même révèlent son essence et ses implications profondes, est à chercher dans les grands pontes de Wall Street, les têtes de Goldmann Sachs notamment qui depuis plus d’une dizaine d’années noyautent le gouvernement américain. La grande collusion entre la politique et la finance, qui a remplacé le goupillon. Bien sûr cette argumentaire est à charge, outré comme à l’habitude. On y découvre des députés et des sénateurs horrifiés par l’état de la démocratie américaine, par la manipulation surtout de la population que l’on convainc à la fois d’avoir peur, de céder à toutes les exigences combien monstrueuses soient-elles, de se taire et de se ranger dès qu’il s’agirait de faire entendre son opinion. Moins bien construit que les précédents, avec une première partie plus longue et mal reliée à la problématique générale, ce film émeut pourtant, convainc aussi que rien n’est jamais joué d’avance, que des choses mêmes infimes peuvent être modifiées dans un système pour avoir au final de véritables conséquences.
Logique, le premier film que j’ai vu en venant en France cette fois-ci a été Capitalism : A Love Story (2009), qui renoue avec la démonstration chère à Michael Moore : expliciter les tenants et les aboutissants d’un système économique et financier conduisant à des aberrations, ici personnifié, allégorisé sous les traits de Wall Street. Les expulsions, les licenciements, liés à une surenchère de paris très profitables sur des subprimes, des produits dérivés, des produits exotiques qui engagent en revanche la vie quotidienne de ceux qui ne retireront rien d’éventuels profits. Pour Michael Moore, l’origine de telles pratiques, qui détournent le capitalisme ou peut-être même révèlent son essence et ses implications profondes, est à chercher dans les grands pontes de Wall Street, les têtes de Goldmann Sachs notamment qui depuis plus d’une dizaine d’années noyautent le gouvernement américain. La grande collusion entre la politique et la finance, qui a remplacé le goupillon. Bien sûr cette argumentaire est à charge, outré comme à l’habitude. On y découvre des députés et des sénateurs horrifiés par l’état de la démocratie américaine, par la manipulation surtout de la population que l’on convainc à la fois d’avoir peur, de céder à toutes les exigences combien monstrueuses soient-elles, de se taire et de se ranger dès qu’il s’agirait de faire entendre son opinion. Moins bien construit que les précédents, avec une première partie plus longue et mal reliée à la problématique générale, ce film émeut pourtant, convainc aussi que rien n’est jamais joué d’avance, que des choses mêmes infimes peuvent être modifiées dans un système pour avoir au final de véritables conséquences.
Alors, on s’interroge : cette petite baisse de dynamisme signifie-t-elle que Michael Moore fatiguerait un peu ? Que l’agitateur politique, polémiste, outré, se lasserait e se battre non contre des moulins à vent mais des mastodontes tellement énormes que l’on a le sentiment que c’est peine perdue d’avance ? Non, ne fléchis pas…
 (0)Boah...
(0)Boah... (0)
(0)